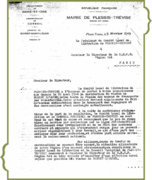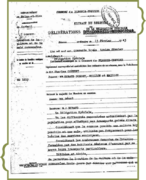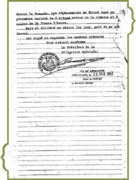Les moyens de transports dans les années 40
Si, dès 1938, le maire du Plessis-Trévise, Georges Foureau, s’inquiète et attire l’attention des autorités sur l'insuffisance des moyens de transport dont disposent les habitants de la commune, les difficultés vont nettement s’aggraver durant la seconde guerre.
Sous l’occupation allemande, les déplacements sont un réel problème. Devant la disparition des voitures automobiles, faute de carburant, la bicyclette devient alors un moyen de transport très prisé, sinon indispensable, particulièrement pour le ravitaillement.
C’est la grande époque du système D, comme débrouillardise. En effet, les pneus de vélo sont eux aussi rationnés. Les chambres à air se couvrent de rustines ou encore de bouchons de liège. Il arrive même que les cyclistes mettent deux vieux pneus, l’un sur l’autre. On confectionne des pneus pleins avec des vieilles chambres à air ou de vieux pneus d’autos sur des roues en bois de frêne, résistant et souple. L’asphalte résonne désormais, non seulement sous les énormes semelles de bois des chaussures de femmes ou des galoches d’enfants, mais aussi, sous les démocratiques vélos empruntés par tous, sac à dos et porte-bagage débordant.
Les nombreux utilisateurs de la « petite reine » se voient pourtant dans l’obligation de respecter bon nombre d’obligations. Il faut d’abord apposer une plaque métallique sur le cadre, indiquant que vous avez bien payé la « taxe sur les vélocipèdes » de l’année.
Au vu des besoins en cuivre et en laiton de l’envahisseur allemand, la production fut arrêtée et remplacée par une nouvelle série en métal blanc.
En 1942, la plaque fut imprimée sur du carton comme fac-similé de la plaque en métal. Le tarif passa cette année à 25 francs.
En 1943, la plaque de vélo a été émise sous la forme d’un timbre qu’il était possible de coller sur un support ou un morceau de carton.
Vous devez ensuite peindre une bande blanche sur votre garde-boue arrière et vous assurer que votre phare ne diffuse pas trop de lumière, en vertu des mesures de défense passive. Toutefois, vous devez circuler uniquement de jour, le couvre-feu instauré par les allemands interdisant tout déplacement nocturne, en dehors des professions dites essentielles (comme le médecin) ou de fonctions particulières (comme le maire ou le chef des pompiers). Dans le cas présent, il faut disposer d’un laisser passer appelé « Ausweis » par les occupants, justifiant votre situation.
Les vélos font alors parti des objets les plus convoités du moment avec l’alimentation et le charbon.
En 1944, près de deux millions de bicyclettes sont immatriculées, rien que pour Paris.
Les vélos neufs et un peu perfectionnés valaient presque le prix d’une petite voiture d’avant-guerre, tandis que les vieux clous les plus rafistolés étaient disponibles à partir de 2 500 francs, soit le salaire mensuel d’un ouvrier qualifié !
Bien vite, au Plessis-Trévise, l’habituel camion de grossiste portant réclame de la sympathique « Vache qui Rit » ne sera plus dans la capacité de livrer les produits alimentaires.
Le seul commerçant possédant encore une camionnette, qui était désigné pour regrouper les achats et aller aux Halles de Paris, n’est plus en état d’assurer l’approvisionnement.
Jean Tusseau nous raconte :
« En octobre 1940, j’aidais mon frère André et sa femme Marie dans leur commerce d’alimentation, avenue Ardouin. Nous allions aux Halles de Paris ou chez les vins Postillon au pont de Conflans à Ivry, avec une vieille camionnette Renault à capote, avec remorque. Nous partions au couvre-feu, à 5 heures du matin. Déjà, une véritable aventure !
Eté 1941 : les allemands nous ont retiré la camionnette lors d’une visite à Boissy- Saint-Léger car ne donnant plus d’essence, ils supprimaient le plus de voitures possible.
Dès lors, tout le ravitaillement se fera en vélo et souvent avec la remorque chargée, parfois 100 kg et plus, ce qui naturellement augmentait les difficultés.
Deux fois par semaine, j’allais au Perreux chez le grossiste beurre et fromage, chez Géo au Kremlin-Bicêtre, aux confitures Bannier à Epinay-sur-Seine (66 km aller-retour) chez Buitoni à Saint-Maur, chez Byrrh et Saint-Raphaël à Ivry et Charenton, mais aussi chez Maggi-Kub à Paris, ou encore aux Pavillons Baltard des Halles (40 km aller-retour), sans oublier les graines à Villeneuve- Saint-Georges (En ces temps de grande restriction, chacun à à cœur de cultiver son propre carré potager, le rutabaga et le topinambour, légumes jusqu’alors méprisés font leur réapparition).
Une fois, pour une cliente du Plessis, je suis allé chercher des petits canards, toujours à vélo avec la remorque. Je lui ai rapporté chez elle au Monument (40 km en 4 heures) ! »
Film de quelques minutes - Auteur : INA.fr -
Visible sur site
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000221/les-nouveaux-moyens-de-locomotion-a-paris.html
Le transport public est restreint. Le 5 février 1945, le président du Comité local de Libération s’émeut de la situation auprès du directeur de la S.N.C.F. de la Région Est :
« La destruction du viaduc de Nogent-sur-Marne, le 20 aout 1944, prive toute la région des moyens de transports par voies ferrées. Cette situation devient angoissante du fait qu’aucune amélioration dans le transport des voyageurs et des marchandises n’est envisagée actuellement. Le peu de rames mises en service par dérivation sur la ligne Paris-Bastille fonctionnent avec irrégularité et de ce fait les nombreux ouvriers et employés qui l’empruntent chaque jour, ne peuvent arriver régulièrement à leur travail, ce qui est un handicap dans leur profession et nettement une entrave au redressement national. Par ailleurs, le trafic des marchandises ne pouvant être assuré, la situation alimentaire de notre région s’en ressent sérieusement »
Courrier du Président du Comité Local de Libération - 5 février 1945.
Auparavant, le 13 février 1943, la Délégation Spéciale de la commune du Plessis-Trévise, sous la présidence de Charles Coudert, était appelée à délibérer sur les nombreuses demandes de location formulées par des habitants concernant une voiture hippomobile et une mule, toutes deux utilisées peu fréquemment pour les besoins des services municipaux.
Les membres de la Délégation décident, par conséquent, de permettre la location de la mule et de son attelage, trois jours par semaine aux personnes qui en feront la demande.
Les déplacements sont établis dans un périmètre de 6 kilomètres autour de la commune et à raison de 25 francs de l’heure. Toutefois, certains racontent qu’il n’est pas rare de pousser la mule et la charrette, toutes deux bien chargées, jusqu’aux Halles de Paris.
Délibération de la Délégation Spéciale - 13 février 1943
Mais, cette mule aura un coût pour la commune : le ferrage, l’alimentation, l’entretien de la voiture, estimés à 11 460 francs pour l’année 1943, vont s’avérer près de quatre fois supérieurs à celui de la location qui est de 3 235 francs. De sorte, cette brave mule, après avoir rendu tant de bons services, finira sa vie à l’abattoir du boucher local.
Quant à sa remise, située dans une dépendance de la Mairie, elle deviendra, après guerre, le réfectoire scolaire, bien connu des anciens, sous le nom de « L’écurie de la mule ».
La mule ressemble plus à un cheval qu’à un âne. Elle a pour père un âne et pour mère, une jument.
La mule est de sexe féminin, mais elle est stérile et ne peut donner naissance à des petits.
Les mules sont plus grandes et plus fortes que les ânes, mais elles ont des oreilles plus petites. Elles ne braient pas comme un âne mais ne hennissent pas vraiment non plus comme un cheval. Chaque mule émet des sons originaux. Selon les races des parents, il existe différentes races de mule. Les mules de bât peuvent transporter des marchandises sur leur dos. Les mules de trait peuvent faire des travaux agricoles dans les champs et les mules de selle sont utilisées pour la randonnée.
On dit « têtue comme une mule » pourtant les mules ne sont pas plus têtues que les ânes, mais comme eux quand elles ont peur, elles refusent d’avancer, alors qu’au contraire, un cheval qui a peur, prend la fuite. De nos jours, les mules sont rares. Peu naissent chaque année.