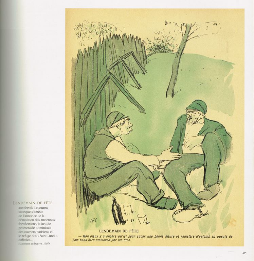Sombre lundi
au "cabaret des Vrais Chasseurs"
Dans « Le journal » daté du 15 mars 1911, un fait divers fait la Une de l’actualité. L'article est accompagné d'une photo, reprise dans le bandeau de cette page.
Retranscrit dans son intégralité ci-après, il nous rappelle que ce n’était pas « la Belle Epoque » pour tout le monde !
Le cadre
« On fêtait joyeusement le lundi (cf. note 1), au cabaret des « Vrais Chasseurs » tenu par les époux Ridon, en plein Bois de Gaumont, à deux pas de Villiers-sur-Marne. Ce coquet établissement, situé au n° 28 de l’avenue des Mousquetaires, est bien connu des Parisiens qui, l’été venu, fréquentaient cette jolie contrée.
Il y avait là plusieurs consommateurs : M. Louis Dabit, le puisatier de Plessis-Trévise, M. Foucault rentier, M. Alphonse Colluche blanchisseur au Plessis, Mme Babot une voisine, M. Pierre Guillon terrassier et pensionnaire du cabaret, Mrs Jean-Louis Perron et Charles Ridon, beau-frère et frère du débitant. Tout ce monde choquait gaiement les verres en narguant les giboulées de mars qui faisaient rage au dehors, quand, vers quatre heures de l’après-midi, la porte s’ouvrit brusquement.
Les événements
Chacun s’arrêta de rire, car les nouveaux arrivants étaient particulièrement redoutés. "Attention ! " - s’écria quelqu’un ; "voilà Denis le Tatoué et sa femme".
« Denis le Tatoué » ainsi dénommé parce que son corps n’est plus qu’un amas de bariolages, est un serrurier qui porte gaillardement la cinquantaine. En réalité, il s’appelle Denis Seurat, travaille momentanément chez M. Muel, de Villiers et demeure avenue de Combault.
D’où vient-il ? On ne le sait. Dans ses moments de saoûleries, il se vante d’avoir servi au « Bat. d’Af. » (cf. note 2) et d’être titulaire de dix-huit condamnations pour coups et blessures.
On craint « Denis le Tatoué » partout car, à tous propos, il n’hésite pas à jouer du couteau et du revolver.
« Denis le Tatoué » commença par s’emparer d’une bouteille et la briser à terre. Puis, comme il était surexcité par les vapeurs de l’alcool, il interpella chacun des clients.
- T’as de feignants ! s’écria-t-il vous n’auriez pas été capables d’aller à la guerre.
C’est là un de ses thèmes de dispute favoris.
Il s’en prit directement à M. Dabit qui, il y a deux ans, dû être amputé du bras droit, à la suite d’une piqûre de forme grave.
- Tu n’as pas honte de t’adresser à un manchot ? lui répondit M. Colluche
Ce fut le signal de la rixe. « Denis le Tatoué » sortit brusquement un révolver de sa poche et tira cinq balles. L’une effleura M. Colluche à la joue droite (cf. note 3) et alla se loger dans le plafond, pendant que deux autres atteignaient l’infortuné M. Dabit à l’abdomen et à la cuisse droite.
La mêlée était épouvantable. Les femmes qui portaient des bébés dans leurs bras s’enfuyaient en poussant des cris éperdus. Quant aux hommes, ils s’étaient élancés sur le meurtrier qui, grâce à sa force herculéenne, les tenait tous en respect. Mme Louis Ridon, la cabaretière, roulait à terre avec sa petite fille Luce. M. Pierre Guillon qui venait, lui aussi, d’être touché légèrement par un projectile, avait la figure ensanglantée.
Au milieu des cris de rage et de douleur, le « Tatoué » s’élança, écumant de colère sur M. Dabit, qui gisait à terre, et lui mordit cruellement les doigts, pendant que sa femme, Eugénie, femme de ménage, frappait la malheureuse victime à coups de sabot et disait à son mari, en lui offrant des balles tirées de son tablier :
- Descends les donc !
Cette scène épouvantable dura un long quart d’heure au bout duquel M. Perron parvint à désarmer le forcené qui fut conduit au poste de police de la mairie par M. Charles Ridon et le garde-champêtre Charles Selers.
Epilogue
M. Louis Dabit a été transporté à son domicile, 8 avenue Thérèse au Plessis-Trévise. Le docteur Gorse qui lui a prodigué ses soins, estime que son état est désespéré. Le malheureux qui appartient à une des plus anciennes familles du pays, jouit, au Plessis, de la considération générale. Il décèdera le lendemain des suites de ses blessures.
Dans la matinée, le Parquet de Corbeil, composé de MM. Fortin, procureur de la République, Gridel, juge d’instruction, Villemot, greffier, et du docteur Durey-Comte médecin légiste, s’est transporté sur les lieux du drame.
« Denis le Tatoué » a été écroué à la prison de Corbeil, tandis que sa femme était invitée à se tenir à la disposition de la justice. »
Le 18 juillet 1911, la Cour d’Assises de Seine & Oise, siégeant à Versailles, condamnera Denis Seurat à dix ans de travaux forcés, pour coups et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner et port d’arme prohibée.
Notes
(1) La saint Lundi
Respectée jusqu’à la fin du XIXe siècle, totalement oubliée aujourd’hui, la Saint-Lundi aura été une des manifestations les plus originales de l’identité ouvrière. Fortement dédiée à la fête et à l’alcool, elle rassemblait ce jour-là, surtout dans les grandes villes, les artisans ouvriers pour une journée de fête communautaire « entre hommes » alors que le dimanche est plutôt consacré aux affaires domestiques.
"En général, le lundi est pour ces ouvriers un jour de plaisir ; ils abandonnent leurs ateliers, se rendent hors barrière dans les établissements de marchands de vin et font des excès de boisson. Ils deviennent alors turbulents, et beaucoup plus disposés à méconnaître les mesures d’ordre » note en 1830 le Préfet de Police de Paris, cité par Robert Beck. Balzac souligne aussi cette dichotomie des temps et formes des loisirs entre dimanche bourgeois rangé et Saint-Lundi ouvrière alcoolisée. Pliant sous les coups de boutoir d’une révolution industrielle, qui rationalise les temps de production et prive de repos hebdomadaire les ouvriers de manufactures, la Saint-Lundi déclinera dès les premières années de la IIIe république. L’image de débauche qu’elle véhicule, ne lui permettra pas de résister très longtemps.
Mais la quasi-disparition de la Saint Lundi vers la fin du XIXe siècle s’explique aussi par la désaffection d’une grande partie de la classe ouvrière pour cette coutume dorénavant mal famée. Elle lui préfère le repos du dimanche, jour de famille, de loisirs et, désormais, d’activités politiques et syndicales.
(2) Bat. d'Af.
Les Bataillons d’Infanterie Légère d’Afrique (BILA) connus sous les surnoms de Bat’ d’Af’ étaient des unités relevant de l’Armée d’Afrique, composante de l’armée de terre française.
L’infanterie légère d’Afrique a été créée en juin 1832 pour "recycler" les militaires condamnés à des peines correctionnelles par la justice militaire et des militaires sanctionnés par l’envoi dans les compagnies de discipline. Cantonnées en Afrique du Nord, à Biribi, nom générique pour désigner leur casernement, ces unités constituent l’instrument répressif de l’Armée française : utilisées initialement pour écarter les fortes têtes, elles sont conçues pour redresser « ceux qui ont failli ».
A partir de 1836, ces unités accueillent également des conscrits frappés par une condamnation de droit commun ou connus pour leurs activités illégales. A partir de 1889, la spécificité de son recrutement, fait des bataillons d’Afrique un endroit privilégié pour forger les réseaux du milieu criminel de l’entre-deux-guerres. Ils avaient, dit la tradition, tatoué sur les jambes « marche ou crève » et parfois sur les bras « né sous l’étoile du malheur, mort sous l’étoile du bonheur » en hommage à leur fétiche, l’étoile du bazar. C’est à cela qu’ils étaient reconnus et respectés, voire craints, non seulement dans le milieu mais aussi dans la société civile.
La loi du 21 mars 1905 sur le Service Militaire réglementera les catégories judiciaires susceptibles d’être incorporées dans les Bataillons d’Infanterie Légère d’Afrique.
Durant la Grande Guerre, trois Bataillons de Marche se sont distingués en métropole.
(3) Colluche et sa cicatrice
Alphonse Colluche portait à la joue, une cicatrice particulièrement visible qui a alimenté bien des commentaires : blessure d’enfance en tombant sur une trompette, selon une de ses filles, blessure lors de la Grande Guerre, jets de cailloux à la place de tomates lors d’une attraction à la Foire de Monthéty, selon d'autres. En fait, la blessure énoncée dans cet article, pourrait bien être à l’origine de cette cicatrice.
Retrouver A.Colluche dans la rubrique consacrée à la guerre 1914-1918 en cliquant ici.