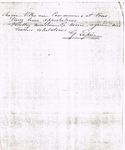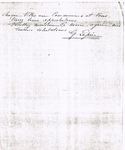Toujours une histoire d'eau
Bains-Douches, l'eau courante ...
Se laver les mains sous l’eau du robinet, prendre une douche le matin au réveil ou se plonger dans un bain chaud, sont des habitudes ancrées dans le quotidien. Mais, l’eau courante n’a pas toujours été une évidence par le passé.
Précision :
L'eau courante est une eau potable transportée par un réseau de canalisations depuis son point de captage (source, forage, rivière, etc.) jusqu'à un point de distribution. L'eau courante
est aussi désignée par les termes "eau de distribution" ou "eau de robinet" dès lors qu'elle arrive jusqu'aux robinets des utilisateurs (ménages, entreprises, bâtiments publics,
etc.).
Au début du 20e siècle, lors de la création de la commune, la très grande majorité de ses habitants devait se contenter d’ablutions d’eau froide tirée du puits : cuvette, brocs, seau, étaient les accessoires courants et indispensables de la toilette. La bouilloire sur le poêle dispensait un peu d’eau chaude ou éventuellement, à la belle saison, le baquet d’eau chauffée au soleil de l’été.
Toutefois, une politique hygiéniste se met en place. La loi du 15 février 1902 impose à chaque commune l’obligation d’assurer de l’eau potable à ses habitants. Mais, avant tout, à cette même époque, les édiles du Plessis-Trévise doivent résoudre le difficile problème de l’écoulement des eaux usées polluant l’eau des puits.
Prendre un bain était alors un luxe que Marie Hortense Montpellier rendra accessible en signant avec la municipalité, le 23 août 1902, un protocole d’accord pour la création de bains publics, passage des Ecoles. Les conditions d'exploitation de cet établissement de lavoirs et de bains publics seront confirmés par un nouveau protocope d'accord signé entre la commune du Plessis-Trévise et les époux Fleury (Mme Veuve Montpellier ayant épousé en seconde noce M. Alphonse Fleury)
Revoir le texte de ces protocoles d'accord ici en un clic sur la page "Les lavandières"
Cet établissement de bains, subventionné par la municipalité, était composé de quatre pièces :
- deux pièces avec baignoire en zinc,
- une pièce avec baignoire émaillée pour les bains sulfureux dit de Barèges (à base de sulfure de soude afin d’imiter les eaux thermales de Barèges dans les Pyrénées) très prisés à cette époque,
- enfin une dernière pièce disposait d’une douche.
Des chauffe-bains en cuivre assuraient la production d’eau chaude, ils seront remplacés au cours des années 1930 par une chaudière.
Il fallait alors débourser entre 15 et 25 centimes de francs pour prendre un bain.
Sachant, qu’à titre de comparaison, 1 kg de pain coûtait alors environ 2 francs, un manouvrier était payé en moyenne 3,50 francs de l’heure. Il semblerait donc, qu’un bain était abordable pour une majorité de personnes, au moins de manière hebdomadaire ! Il est à noter, toutefois, que ces bains n’étaient ouverts qu’à la saison estivale. Cela voulait-il dire qu’ils étaient particulièrement destinés aux propriétaires des grandes villas qui ne séjournaient au village qu’à la belle saison ?
Il faudra attendre le 26 juillet 1947 pour que le conseil municipal, prenant en considération le souhait de la population et le besoin réel de celle-ci, adopte le projet de construction de douches municipales.
L’emplacement choisi, dans le parc de la mairie, fait l’unanimité. L’architecte Louis Germain réalise un plan prévoyant 10 cabines de douches, auquel est joint un devis descriptif chiffré, très détaillé. Un budget de 1 300 000 francs est voté par la commune, des subventions sont demandées à l’Etat et au département.
En vain… le projet ne verra pas le jour.
Jusque dans les années 1950, les bains-douches municipaux resteront le symbole de l’hygiène populaire.
Mais, c’est aussi à cette époque que les premières "salles de bain" font leur apparition dans les foyers.
Il faut dire qu’entre temps, l’arrivée de l’eau courante a fait son chemin.
Le 22 novembre 1925, le Conseil municipal donne l’autorisation au maire de la commune de passer un marché de gré-à-gré avec la Compagnie Générale des Eaux, pour l’installation d’une première borne-fontaine à l’intersection des avenues Maurice Berteaux et de Champigny (actuelle av. du Gal Leclerc).
Au cours des années 1930, l’Office National d’hygiène sociale, sous l’égide du Ministère du travail, met en place une large politique de l’eau. Une brochure très explicite (voir extraits ci-dessous) est envoyée aux Conseillers municipaux et Conseillers généraux afin de leur rappeler les bienfaits d’une eau saine pour leurs administrés et leur indiquer les ressources financières dont ils disposent pour effectuer des adductions d’eau.
Le 9 mars 1930, le Conseil municipal autorise l’acquisition d’un terrain, avenue de la Villa Trévise, afin d’y effectuer le forage d’un puits et d’y construire un château d’eau, permettant d’alimenter, très progressivement, des foyers en eau potable.
Plusieurs années s'écouleront avant la construction de ce premier château d'eau. La date de sa mise en service reste à préciser - il ne figure pas sur la vue aérienne de 1933. Sa présence est attestée par les différentes vues aériennes du Plessis-Trévise entre 1955 et 1983. Il sera détruit quelques années plus tard.
Précision : le château d'eau actuel (situé avenue de la Maréchale près du groupe scolaire Monnet-Moulin) a été érigé au début des années 1962, pour faire face à l'augmentation rapide du nombre d'habitants après la construction de la Cité de la Joie et des autres quartiers.
En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il était encore dénombré 7 bornes-fontaines sur la commune. Comme l'indiquent les relevés de compteurs illustrés ci-dessous, les autres points de distribution sont à la mairie (Av. Ardouin), au bureau des P.T.T. (Av. de Champigny), à la cantine scolaire (Av. Ardouin) et au groupe scolaire (Passage des Ecoles). La consommation pour 6 mois (de décembre 1944 à juin 1945) est alors de 431 m3 ...
La galerie vous propose également deux plans du réseau de distribution d'eau dans la commune, un de 1938 et un de 1949, sur lesquels il est possible de visualiser les emplacements des bornes fontaines (BF) mais aussi le réseau à ces dates et les extensions projetées.
Le rapport de l’homme avec l’eau, ce bien si précieux, restera une préoccupation essentielle à toutes époques.
Exemples de courrier adressés par des habitants au Maire du Plessis-Trévise en 1900 et1937.
En décembre 1963, René Ledent, alors conseiller municipal, écrit dans le bulletin communal :
« Après bien des vicissitudes, dans quelques mois, l’eau potable sera distribuée dans toutes les voies habitées de la commune ».
Le 8 mars 1968, le Conseil municipal apporte son soutien à l’ « Union des Utilisateurs d’eau du Plessis-Trévise » qui a pour but l’obtention d’une eau incolore, inodore, sans saveur, devant constamment présenter les qualités requises par le Conseil supérieur d’hygiène de France et par les instructions du Ministère de la Santé.
En 1985, devant le développement de l’urbanisation, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) assurait de sa volonté de garantir la qualité de l’eau et son confort d’utilisation.
Notion qui reste naturellement toujours d’actualité ....